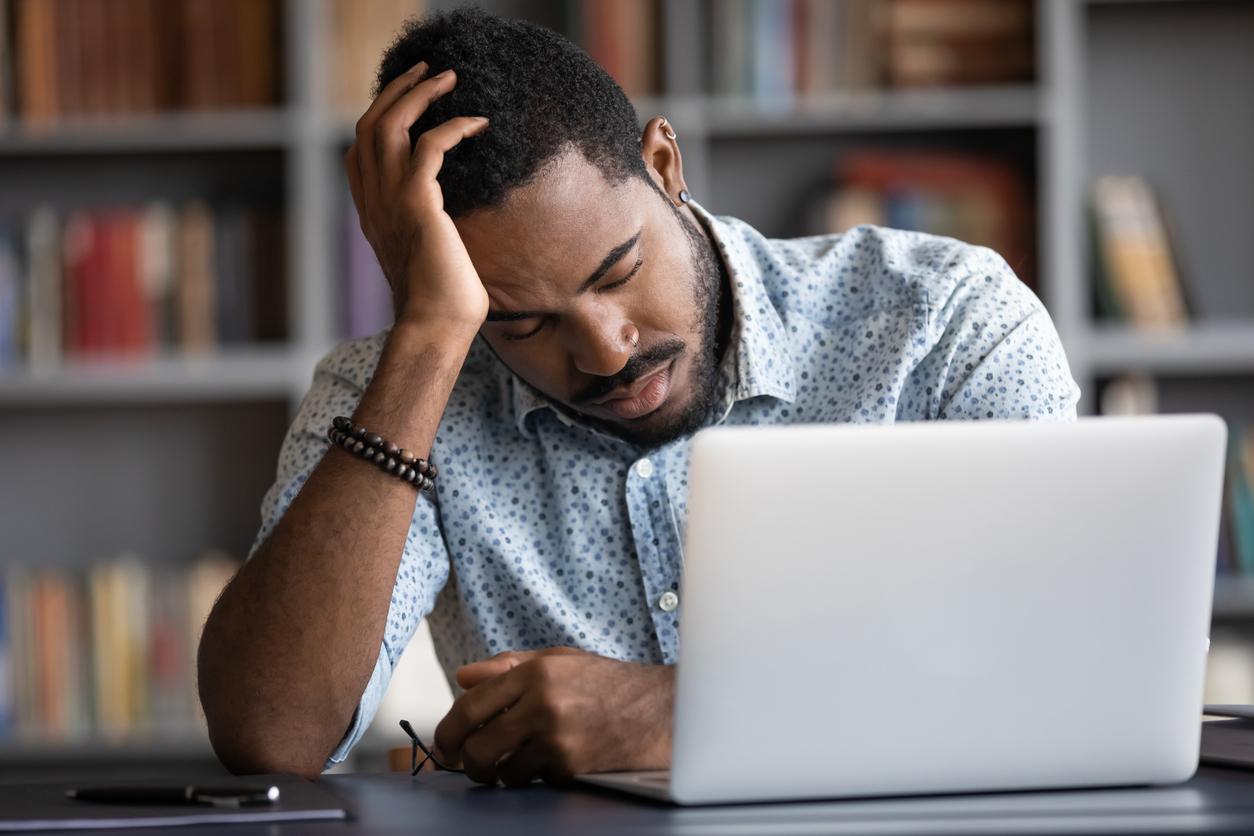
La narcolepsie est une pathologie rare du sommeil aux multiples conséquences sur le quotidien. Qu’est-ce que c’est exactement ? Comment l’expliquer et la traiter ? Décryptage.
Qu’est-ce que la narcolepsie ?
La narcolepsie est un trouble du sommeil chronique qui se manifeste par des épisodes soudains et irrésistibles de sommeil, correspondant à des besoins excessifs de ce dernier. La narcolepsie est considérée comme une maladie neurologique rare provoquant des perturbations importantes de la vie quotidienne.
Il existe deux types de narcolepsie.
La narcolepsie de type 1
Ce type de narcolepsie concerne environ 1 personne sur 5000, d’après l’Inserm. Elle apparaît généralement à l’adolescence ou chez les jeunes adultes. Un tiers des patients concernés est en situation d’obésité. Les scientifiques ont également souligné la responsabilité d’une prédisposition génétique particulière.
La narcolepsie de type 1 est causée par un déficit en orexine (ou hypocrétine), une molécule qui assure la transmission des messages d’un neurone à l’autre (neurotransmetteur), notamment concernant l’éveil.
La narcolepsie de type 2
Contrairement à la narcolepsie de type 1, il n’y a pas de cause connue à ce jour pour expliquer la narcolepsie de type 2 : aucune prédisposition génétique à cette maladie n’a encore été identifiée et les taux d’orexine ne sont pas diminués. Ils peuvent, à la rigueur, être légèrement en baisse. Dans ce cas, il arrive que la maladie soit reclassée en narcolepsie de type 1.
La narcolepsie fait partie des hypersomnolences
L’hypersomnolence correspond à un excès de sommeil. On parle généralement d’hypersomnolence d’origine centrale (c’est-à-dire qui trouvent leur origine dans le cerveau) pour regrouper 4 pathologies chroniques rares : la narcolepsie de type 1, la narcolepsie de type 2, le syndrome de Kleine-Levin et l’hypersomnie idiopathique.
L’ensemble de ces maladies associe plusieurs symptômes de sévérité et de fréquence variables :
-
Une quantité excessive de sommeil ;
-
Une somnolence également excessive pendant la journée ;
-
Des difficultés à atteindre un état d’éveil complet après une période de sommeil : confusion, désorientation, troubles de la coordination motrice ;
-
Des endormissements irrépressibles pendant la journée.
En cas d’hypersomnolence, ces symptômes ne sont associés à aucune pathologie sous-jacente ou manque de sommeil. Mais à des dysfonctionnements cérébraux des systèmes de régulation des états de veille et de sommeil. Les hypersomnolences sont toutes responsables de l’altération de la qualité de vie et d’un risque important d’accidents.
Reconnaître la narcolepsie : quels sont ses symptômes ?
La narcolepsie de type 1 se manifeste par un sommeil nocturne d’une durée normale mais d’une qualité médiocre avec de nombreux réveils.
Pendant la journée, les patients souffrent de somnolence excessive, avec des endormissements irrépressibles. Ces épisodes peuvent survenir à tout moment, y compris en pleine activité. Au moment de s’endormir ou de se réveiller, ils peuvent subir des hallucinations et une paralysie transitoire d’une durée de quelques secondes à quelques minutes. En outre, ces personnes peuvent également souffrir d’une chute brutale de leur tonus musculaire généralisée ou partielle (ne concernant que le visage, les bras ou les genoux) qui apparaît à la suite d’une émotion agréable, comme le rire. Ce phénomène s’appelle la cataplexie.
Concernant la narcolepsie de type 2, les symptômes sont les mêmes que le type 1, mais avec la cataplexie en moins..
Comment évolue la narcolepsie ?
Avec les années, la somnolence diurne et la cataplexie ont tendance à s’améliorer en cas de narcolepsie de type 1. En revanche, les perturbations du sommeil pendant la nuit tendent à s’aggraver.
En cas de narcolepsie de type 2, l’évolution est variable : elle peut s’aggraver, rester stable ou s’améliorer avec le temps. Dans les deux cas, à l’heure actuelle, la narcolepsie se traite mais ne se guérit pas.
La prise en charge de la narcolepsie
En présence de symptômes narcoleptiques, consultez votre médecin traitant qui pourra vous adresser à un centre de référence et de compétences où vous pourrez consulter un neurologue spécialisé qui procédera au diagnostic.
Les étapes du diagnostic
L’objectif du diagnostic est de prendre en compte les symptômes et leurs conséquences rapportées par les patients, et déterminer l’origine de la pathologie.
Des auto-questionnaires sont utilisés pour évaluer le degré d’hypersomnolence, selon différentes échelles. Le médecin vous demande de tenir un agenda du sommeil pendant 2 semaines, afin d’évaluer la durée et la qualité de vos périodes de sommeil et d’éveil. Il peut être associé à de l’actimétrie qui consiste à porter un bracelet pendant 2 semaines également, pour évaluer les phases de repos et d’activité au quotidien.
Une polysomnographie (PSG) nocturne est programmée : cet examen analyse la quantité de sommeil nocturne à l’aide d’un électroencéphalogramme (mesure de l’activité cérébrale), d’un électro-oculogramme (mesure des mouvements des yeux) et d’un électromyogramme (mesure de l’activité musculaire). Le tout avec une mesure de la fonction respiratoire et cardiaque. Cet examen permet d’éliminer d’autres causes éventuelles de somnolence, comme les apnées du sommeil.
Un test itératif de latence d’endormissement (TILE) évalue votre capacité à vous endormir de manière répétée au cours de la journée, dans des conditions propices à l’endormissement. Le patient est allongé 5 fois dans la journée, avec un espacement de 2 heures entre chaque évaluation, dans l’obscurité et dans le calme pendant 20 minutes, avec une consigne : essayer de dormir. Un électroencéphalogramme est réalisé en parallèle de ce test, afin de repérer les phases d’éveil et de sommeil. Le délai d’endormissement est considéré comme normal au-dessus de 10 minutes et anormal s’il est inférieur à 8 minutes.
Un test de maintien d’éveil (TME) évalue la capacité à rester éveillé en journée dans des conditions favorables à l’endormissement : vous êtes assis pendant 40 minutes dans une pièce à la lumière tamisée et devez essayer de ne pas vous endormir. Ce test est réalisé 4 fois, avec un intervalle de 2 heures entre chacune. Un électroencéphalogramme est également réalisé en parallèle.
Des analyses complémentaires sont également effectuées : bilan sanguin et imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale, notamment.
Narcolepsie : quels traitements ?
Les traitements visent à réduire les symptômes de la narcolepsie et ainsi améliorer la qualité de vie. Ces traitements varient en fonction de votre état de santé et de la sévérité des symptômes. L’un des aspects du traitement consiste à adopter une bonne hygiène de vie, afin de limiter les risques d’hypersomnolence :
-
Eviter de consommer de l’alcool ;
-
Pratiquer une activité physique régulière ;
-
Manger sain et équilibré ;
-
Se coucher à heures fixes ;
-
Programmer des siestes à des horaires définis et d’une durée limitée.
Des médicaments sont souvent associés à ces mesures, notamment des traitements psychostimulants, également appelés « molécules éveillantes » ciblant des circuits neuronaux précis. L’oxybate de sodium stimule certains récepteurs neuronaux et réduit la somnolence diurne excessive, ainsi que le sommeil nocturne fragmenté et la cataplexie.
La narcolepsie doit faire l’objet d’un suivi médical régulier avec une consultation annuelle au minimum.
 Sauvegarder
Sauvegarder